Très souvent, des patients hospitalisés se retrouvent avec des infections dues à des germes multi-résistants aux antibiotiques. Parfois, ils en meurent. Pourtant, aucune information ne filtre sur ces infections appelées «nosocomiales» qui existent partout dans le monde et qui sont considérées comme une priorité de santé publique. Visiblement, ne pas évoquer le problème en Tunisie ne fait que l’aggraver.
Fin mai 2011 à la clinique Soukra, le parterre est brillant et l’odeur du désinfectant envahit et l’atmosphère. Tout sent la fraîcheur et l’hygiène. Personne ne pouvait soupçonner que deux semaines auparavant, une patiente était morte dans cette clinique à la suite d’une infection nosocomiale.
La victime, Inès Ben Njima, avait 33 ans et était mariée. Elle était allée consulter pour une abdominoplastie (opération esthétique sur le ventre). Elle a perdu la vie, laissant deux enfants âgés de 1 an et 5 ans et un mari de 37 ans. Suite à la plainte du mari, le décès a fait l’objet d’une enquête diligentée par le ministère de la Santé, laquelle a bien confirmé l’existence d’un germe «staphylococcus saprophyticus méticilline R» à l’origine de l’infection nosocomiale ayant provoqué un choc septique chez la patiente et sa mort, sept jours après l’intervention chirurgicale. Le rapport de l’autopsie est allé lui aussi dans ce sens. Un procès devrait être ouvert bientôt.
Début février 2012, dans un laboratoire d’analyse à Tunis. S., biologiste, qui souhaite conserver l’anonymat, examine un résultat d’analyse que ses collaborateurs viennent de lui confier. Le patient, hospitalisé pour un problème cardiaque, a attrapé un germe virulent, klebsiella pneumoniae, provoquant chez lui une septicémie (infection grave qui se caractérise par des décharges importantes et répétées dans le sang, de germes pathogènes, provenant d’un foyer). Son cas est grave. Il a développé une infection nosocomiale depuis une semaine dans une clinique de la capitale, et si les médecins ne prennent pas les mesures nécessaires pour le sauver, à savoir, lui administrer des antibiotiques très coûteux et l’isoler, il risque la mort.
Dès qu’elle voit le bilan bactériologique, la biologiste appelle le médecin traitant, qui ne répond pas au téléphone car il se trouvait au service de réanimation. Alors, sans attendre, elle contacte son collègue pour expliquer le cas, et lui demande de réagir tant qu’il est encore temps.
Des cas d’infections nosocomiales, S. en voit quotidiennement dans les différentes cliniques avec lesquelles elle collabore. Elle constate aussi leur fréquence à travers les prélèvements qu’on lui envoie pour identifier les germes à l’origine des infections. Cela ne fait que la scandaliser davantage, surtout qu’elle voit des gens mourir à cause de cela, sans que personne ne prenne la peine ni de les informer de ce qui se passe, eux ou les membres de leurs familles et sans prendre rapidement les dispositions nécessaires pour les sauver.
En témoigne le cas de ce jeune homme de 21 ans, opéré en France pour une tumeur au niveau de la moelle épinière et envoyé ensuite dans une clinique tunisienne pour sa convalescence. C’est là qu’il a contracté une infection nosocomiale, à cause d’une sonde urinaire qui lui avait été posée. Il est sorti de la clinique, mais y est revenu rapidement, car il présentait un état infectieux. «Le résultat des analyses a révélé qu’il avait une septicémie», dit S., en poursuivant : «Sa vie était réellement en danger et il fallait réagir vite. J’ai envoyé par fax les résultats, en précisant que c’était une urgence, avec des recommandations concernant les antibiotiques à utiliser. Les médecins ne les ont pas prises en compte et n’ont pas réagi en temps voulu. Pire encore, j’ai trouvé ensuite le fax, jeté à la poubelle !»
Résultat : le jeune homme est mort d’un choc septique.
L’infection nosocomiale : «une maladie de l’hôpital»
Mais qu’est-ce que l’infection nosocomiale, aux allures d’épidémie par sa fréquence et sa force de frappe ? Et pourquoi évite-t-on d’en parler ?
C’est une infection contractée en milieu hospitalier. Elle se déclenche au bout de 48 heures après l’admission du malade. En dessous de cette période, elle ne peut pas être considérée comme telle. Elle est causée par des germes multi-résistants aux antibiotiques, qui se développent dans les établissements de soins. Ces germes peuvent se trouver sur le matériel médical, sur les surfaces, dans l’environnement, chez le personnel médical et même chez un malade. La contamination se fait généralement d’un patient à un autre, ou via le personnel de soins, qui devient vecteur de circulation des microbes se collant sur ses mains, ses habits ou les instruments qu’il utilise. Il est vrai que l’être humain vit constamment avec des microbes autour de lui, mais quand il est hospitalisé, son immunité diminue et certains germes peuvent devenir virulents.
«Les principales localisations infectieuses sont habituellement les infections urinaires, les infections respiratoires, les infections postopératoires et les bactériémies primaires et secondaires», comme le précise le Dr. Ridha Hamza, du Service régional d’hygiène de Bizerte dans un article scientifique intitulé «Epidémiologie des infections associées aux soins» (janvier 2010).
Le problème des infections nosocomiales est loin d’être spécifique à la Tunisie. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de Santé), «à tout moment, plus de 1,4 million de personnes dans le monde souffrent de complications infectieuses acquises à l’hôpital». L’OMS a d’ailleurs tout un plan à l’échelle mondiale pour lutter contre ces infections, plus connues sous l’appellation «infections liées au soin».
L’usage intensif des antibiotiques à l’origine du mal
La conscience du danger des infections nosocomiales dans le monde remonte à une trentaine d’années. Mais le problème s’est aggravé ces dernières années, notamment à cause de l’usage intensif des produits chimiques et des antibiotiques dans l’agriculture et dans l’élevage. En fait, cela «contribue à la mutation des germes, et ce, à l’échelle mondiale. Ils deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. L’industrie pharmaceutique est en train de courir derrière cette réalité changeante, pour essayer de mettre sur le marché des antibiotiques encore plus puissants», explique Ali Chérif, chef de service d’Anesthésie-réanimation à l’hôpital La Rabta.
De plus, leur prescription fréquente par les médecins et l’accès facile de l’usager tunisien à ce genre de médicaments à travers les pharmacies, intensifient la consommation et multiplie le risque de résistance aux germes. Le Dr. Sami Allagui, médecin généraliste, s’indigne de cette «facilité avec laquelle l’usager peut se procurer des antibiotiques, puisque les pharmacies les vendent librement. Vous ne trouverez pas une chose pareille en France, par exemple, où la vente sans ordonnance est interdite !»
Pour mesurer la gravité du problème en Tunisie, une enquête de prévalence (qui permet de calculer le nombre de cas de maladies présents à un moment donné dans une population) a été réalisée en 2005 sur un ensemble de 7065 malades dans 66 établissements hospitaliers -54 hôpitaux publics et 12 cliniques privées). Elle a démontré que le taux de prévalence des infections nosocomiales est de 6,9%, soit un patient sur sept est touché. Ce taux reste dans la moyenne mondiale, puisque la fréquence globale des infections associées aux soins, démontrées par les études internationales, varie entre 5 à 10% des hospitalisations.
Cette enquête de 2005 est la seule qui a été menée à l’échelle nationale.
Malheureusement, on ne dispose pas encore de statistiques plus récentes pour évaluer l’ampleur du phénomène (une seconde enquête de prévalence est prévue cette année). De telles statistiques sont habituellement réalisées par les CLIN (Comités de lutte contre les infections nosocomiales), qui, théoriquement, devraient exister dans chaque établissement hospitalier. Or ce n’est pas le cas. Par ailleurs, la déclaration des infections nosocomiales au niveau des hôpitaux et des cliniques n’est pas obligatoire pour les médecins.
On ne dispose pas non plus de chiffres sur le taux de mortalité, alors qu’en interrogeant les médecins, ils évoquent l’existence réelle de ce risque. Selon une étude réalisée en 2008 dans le Centre de maternité et de néonatologie de Tunis, dans le cadre de la thèse en médecine de Maher Ben Laiba («Mortalité néonatale au CMNT en 2008, épidémiologie, causes/facteurs de risque», 2010), sur les 14 914 naissances en 2008, il y a eu 151 décès par infection nosocomiale, soit 43% du nombre total des décès (322).
Ces infections ne représentent certes pas la première cause de mortalité chez les nouveaux nés en Tunisie, mais elles peuvent néanmoins être fatales, si les bonnes conditions d’hygiène dans l’établissement hospitalier ne sont pas respectées.
La loi de l’omerta
Le plus inquiétant, c’est que le malade peut développer une infection nosocomiale et en mourir sans que ni lui ni sa famille n’en sachent rien, puisque souvent on ne les avisera pas. Dorra raconte l’histoire de son père, opéré pour une fracture du col du fémur. Pendant des semaines, il a souffert de complications, multipliant les entrées et sorties de la clinique sans comprendre réellement de quoi il souffrait. Les membres de sa famille ont alors décidé de le changer d’établissement de soins, en espérant que son état s’améliore, mais en vain. Il était constamment sous antibiotiques forts.
«Ce n’est que par hasard, et en montrant ses analyses à une cousine médecin, qu’on a compris qu’il souffrait d’une infection nosocomiale contractée après l’opération». Il a fini par mourir.
Pourquoi donc cette omerta ? Solidarité entre médecins ? Peur de perdre leur réputation pour les cliniques privées, puisqu’en cas d’infections nosocomiales, l’établissement de santé (public ou privé) est le premier à être mis en cause?
Oui, mais rien ne justifie l’absence d’une information transparente à donner au patient. C’est son droit le plus absolu.
Payer pour la faute des autres
Or, ce qui survient généralement, c’est que le malade est non seulement non informé de son état, mais de plus, il devra payer les frais supplémentaires, dus à la prolongation de la durée de son hospitalisation et à l’usage de coûteux antibiotiques pour éliminer les germes responsables de son infection. «J’ai vu des patients payer 300 à 400 dinars par jour de frais supplémentaires dans des cliniques, à cause des infections nosocomiales», affirme le Dr. Alllagui. Un malade dans une clinique à Sfax a dû payer une note s’élevant à 7000 dinars pour une infection nosocomiale !
Reconnaître l’existence des infections nosocomiales revient aussi à rembourser les patients, ou à proposer des compensations aux malades ou à leurs familles en cas de complications graves ou de décès. C’est ce que les responsables des établissements médicaux, notamment privés, voudraient éviter à tout prix. L’enquête nationale de prévalence de 2005 a montré que le taux de prévalence des infections nosocomiales est de 10,1% dans les cliniques et de 7,4% dans les Centres Hospitalo-universitaires.
Mais il se trouve que certaines familles de patients se rendent compte, malgré tout et par leurs propres moyens, de l’existence d’une infection nosocomiale et elles obligent les directeurs des cliniques à reconnaitre leurs torts. Le Dr. Allagui nous rapporte le cas de cette patiente de 56 ans, opérée pour une appendicite et qui avait attrapé un germe multi-résistant, le Staphylococcus aureus (MRSA), en clinique, ce qui lui a valu d’entrer dans le coma pendant plus de deux mois. Sa sœur, médecin, avait eu le bon réflexe de prendre des échantillons du matériel utilisé dans le bloc opératoire (gants, seringues, déchets…) pour les soumettre à un laboratoire afin de les analyser, de façon à identifier le germe en question ainsi que sa provenance. Puis elle est revenue, avec ces preuves, vers la direction de la clinique, en menaçant de porter plainte. La direction a accepté de payer des compensations afin d’éviter un tel scénario.
Le manque de moyens : un vrai handicap
Mais qu’est-ce qui explique la fréquence des infections nosocomiales dans nos institutions hospitalières, et pourquoi ne lutte-t-on pas assez contre ce problème ?
Le manque de moyens financiers et humains est la première cause évoquée par les professionnels de santé. Car la lutte contre les infections nosocomiales passe par un système de qualité de l’hygiène dans les établissements en question. Or, cela se réalise à plusieurs niveaux, comme le précise le Pr. Lamine Dhidah, Chef de service d’hygiène hospitalière au CHU de Sahloul et l’un des premiers en Tunisie à avoir travaillé sur les infections nosocomiales : le choix de l’emplacement de l’hôpital et de son architecture, de façon à séparer les services et à assurer des circuits différents pour le transport des aliments et des déchets ; la garantie d’une hygiène stricte et régulière de l’air ambiant, de l’eau, des aliments et des surfaces ; la gestion des déchets hospitaliers et la garantie d’une parfaite propreté, aussi bien au niveau du personnel hospitalier qu’au niveau des malades, avec un contrôle permanent et rigoureux.
Tout cela nécessite beaucoup de moyens que toutes les institutions hospitalières ne sont pas toujours disposées – ou capables – de mettre en place. Le premier problème qui se pose est la composition même du service d’hygiène.
Une circulaire du ministère de la Santé, publiée en date du 25 janvier 1990 précise cette composition qui réunit une dizaine de personnes de différentes spécialités (chefs de services chirurgie, hygiène, pédiatrie, gynécologie, nutritionniste, surveillant général…) En réalité, cette équipe se réduit souvent à trois ou quatre personnes, parfois une seule, notamment dans les cliniques où l’on trouve un hygiéniste, et parfois rien du tout.
Par ailleurs, les opérations de contrôle d’hygiène effectuées par les inspecteurs travaillant sous l’égide de la Direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au sein du ministère de la Santé, restent en deçà de la demande réelle pour instaurer un vrai système de qualité. En effet, 31 524 opérations d’inspection ont été réalisées en 2010 dans les établissements hospitaliers sur tout le territoire, contre 24 482 en 2011, par 584 inspecteurs. La fréquence des inspections varie entre une visite chaque semaine ou chaque mois, selon l’urgence de la situation en matière d’hygiène, pour un ensemble de 118 cliniques et de 172 hôpitaux. M. Mohamed Rabhi, directeur de la Direction de l’hygiène hospitalière, au sein du ministère de la Santé, reconnait qu’il y a un manque de moyens humains flagrant, qu’il est urgent de combler.
Autre problème qui illustre ce manque de moyens, c’est l’insuffisance de points d’eau pour permettre aux médecins et au personnel paramédical de laver fréquemment leurs mains. Car les études ont prouvé que les mains sont le premier vecteur de transmission des germes, et leur propreté reste la première recommandation à suivre dans toutes les stratégies de prévention. «Se laver les mains, c’est mon combat quotidien au sein de mon service de réanimation à l’hôpital La Rabta. C’est dur d’inculquer cette discipline au personnel médical !», souligne le Dr. Ali Chérif qui explique cette situation, à la fois, par l’insuffisance des ressources et celle de la culture de prévention.
Une étude prospective a été menée pendant la seconde quinzaine de janvier 2009 auprès du personnel soignant de 4 services classés à haut risque infectieux de l’hôpital Farhat Hached de Sousse, son but était de mesurer l’adhésion et la pertinence du lavage des mains : la conformité aux normes en vigueur était seulement de 16,1%1.
Un vrai effort est donc à faire, aussi, au niveau de la sensibilisation du personnel médical dans les établissements de santé et au niveau de sa formation.
L’organisation des séances de formation en matière de prévention contre les infections nosocomiales reste tributaire de la décision des directeurs de ces établissements, qui en fixent aussi la fréquence.
Le surbooking des établissements de soins : la porte ouverte à tous les dérapages
La surcharge du nombre de patients au niveau des structures hospitalières n’aide pas non plus à régler la situation. Pis, elle ouvre la porte à un ensemble de manquements flagrants aux règles d’hygiène, tels que le lavage irrégulier des mains tout en traitant plusieurs malades, la réutilisation d’un matériel à usage unique et la faible fréquence des opérations de désinfection des blocs opératoires. «Parfois, on trouve au niveau des inspections faites, qu’il y a eu utilisation d’un matériel qui non stérilisé, cela arrive en cas de surcharge de travail», note Mohamed Rabhi, directeur de la direction d’hygiène hospitalière au sein du ministère de la Santé.
Le surbooking est aussi à l’origine du manque de salles d’isolement pour séparer les malades ayant contracté une infection nosocomiale. Car généralement, dès qu’un malade déclenche de la fièvre au bout de 48h d’hospitalisation (ce qui est un symptôme de l’infection nosocomiale), le premier réflexe du médecin traitant est de l’isoler pour éviter la contamination des autres malades, en attendant de comprendre la nature et l’origine du germe responsable à travers des prélèvements faits aussi bien sur le sujet lui-même que sur l’environnement direct où il se trouve. Or, cela n’est pas toujours possible, pour cause d’insuffisance de salles. L’enquête de prévalence de 2005 a révélé que sur les 66 établissements y ayant participé, il existait 76 salles d’isolements, soit une moyenne d’une salle d’isolement par établissement, ce qui est insuffisant.
Le bloc opératoire reste le lieu de contagion par excellence en matière d’infections nosocomiales. Deux facteurs favorisent particulièrement cette situation : tout d’abord, la pratique de tout type de chirurgies, sans distinction ou séparation, dans un même lieu. «On ne peut pas réaliser dans un même bloc, la chirurgie dite “sale” (appareil digestif, ORL…) et la chirurgie dite “propre” (esthétique, orthopédie…). Or, cela est très fréquent, notamment dans les cliniques, ce qui augmente le risque de contamination», précise le Dr. Abdelaziz Khalil, spécialiste en orthopédie-traumatologie.
L’usage intensif du bloc opératoire, où l’on pratique jusqu’à 20 à 25 opérations par jour (surtout dans certaines établissements hospitaliers privés), sans donner suffisamment le temps au personnels de l’hygiène d’effectuer leur travail et de désinfecter tout le matériel, contribue aussi à la circulation des germes.
Théoriquement, le bloc doit être désinfecté après chaque opération, mais en réalité, les choses se passent très différemment, pour des raisons essentiellement lucratives.
L’arrivée massive de resortissants Libyens en Tunisie, pendant leur révolution, a encore compliqué la situation. L’afflux de blessés de guerre a généré une pression supplémentaire sur nos hôpitaux et nos cliniques. «Nous avons découvert des germes multi-résistants jamais connus en Tunisie, des germes très virulents, ramenés par les patients libyens», affirme la biologiste S. Elle ajoute : «Les cliniques tunisiennes travaillaient nuit et jour. On a même rajouté des lits dans les locaux administratifs pour accueillir ce flux grandissant ! Cela a certainement eu un effet sur les conditions d’hygiène et a considérablement augmenté les risques d’avoir des infections nosocomiales».
Un coût économique lourd de plus 50 000 000 DT par an
La lutte contre les infections nosocomiales est plus qu’urgente, d’autant plus qu’un tel problème entraîne un coût humain et socio-économique lourd. Un taux de prévalence nationale de 6,7% de malades infectés est équivalent à environ 33.500 patients victimes d’infections nosocomiales par an. Le Pr. Lamine Dhidah précise que le surcoût médical direct dépasse 1700 DT par malade surinfecté, soit un total de plus 50 000 000 DT par an. Cette somme représente pas moins de 5,6% du budget de fonctionnement du ministère de la Santé publique en 2007.
Il existe aujourd’hui en Tunisie une prise de conscience sur la nécessité d’agir. Ainsi, toute une stratégie nationale a été définie par un groupe d’experts et de professeurs spécialisés dans l’hygiène hospitalière. Une Cellule de lutte contre les infections associées aux soins a même été créée au sein du ministère de la Santé, en 2011, à la tête de laquelle se trouve Nawal Fequih. Cette dernière explique que la stratégie va s’articuler autour de cinq axes : réglementation (élaboration d’une base juridique à travers un décret cadre et des textes d’application), formation (en améliorant la formation de base en hygiène hospitalière et la formation continue des professionnels de la santé, sans oublier la sensibilisation), environnement de soins (garantir un environnement salubre dans l’établissement de santé et assurer la gestion des déchets hospitaliers), surveillance (créer un système national permettant de suivre l’évolution des infections liées aux soins et d’aider les professionnels à améliorer leurs pratiques dans ce sens), unification et standardisation des procédures et des pratiques d’hygiène hospitalière et de prévention (l’absence actuelle de normes d’hygiène standardisées, utilisées dans tous les établissements hospitaliers dans le pays, est à déplorer, malgré l’existence de manuels précisant les règles d’hygiène qui sont conformes aux recommandations de l’OMS.)
Cette stratégie nationale a été mise en œuvre durant cette année. Il est aussi prévu de réaliser en automne 2012 la deuxième enquête nationale de prévalence sur les infections nosocomiales..
Espérons que cette stratégie saura limiter la fréquence de ce type d’infections dans nos établissements de santé, car il n’est plus possible de continuer à ignorer l’ampleur du problème il y va de la survie des malades.
Affaire «Clinique du sport» en France :
Le déclencheur de la prise de conscience concernant les infections nosocomiales
En France, l’opinion publique a pris conscience du danger que peuvent représenter les infections nosocomiales à partir de 1997 quand a éclaté, dans la presse, l’affaire de la «Clinique du sport». En effet, le Pr Pierre Sagnet, ancien directeur de cet établissent, avait révélé que le circuit d’eau de la clinique avait été infecté par une bactérie dite «xénopie» entre 1988 et 1993. Durant cette période, 58 patients ont été contaminés suite à des opérations —notamment du rachis— effectuées dans le bloc opératoire avec un matériel chirurgical dont la stérilisation était imparfaite. Cette bactérie engendre une infection nosocomiale qui s’apparente à une tuberculose osseuse provoquant de grandes souffrances et se déclenchant quelques mois ou quelques années après l’intervention chirurgicale. L’affaire, qui a défrayé la chronique, a initié une prise de conscience de l’opinion publique du risque représenté par les infections nosocomiales. Depuis, tout un dispositif administratif a été mis en place pour protéger les droits patients, dont la fameuse «loi Kouchner» du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la création du Pôle santé sécurité soin du Médiateur de la République, lequel a pour mission d’analyser les demandes ou les réclamations mettant en cause le respect du droit des patients, la qualité du système de santé et la sécurité des soins et l’accès aux soins.
Derrière cette prise de conscience du problème, une association, Le Lien, a été particulièrement active ; fondée par Alain-Michel Ceretti, le mari d’une des patientes contaminée lors de l’affaire de la «Clinique du Sport» et qui est aujourd’hui conseiller santé auprès du Médiateur de la République. Ce dernier a pris l’initiative de mener l’enquête et de rassembler les témoignages des malades contaminés. Sa collaboration ultérieure avec la presse a permis de faire éclater l’affaire au grand jour.
L’association, dirigée actuellement par Claude Rambaud, continue de travailler sur le volet «sensibilisation» du corps médical et celui de l’accompagnement des patients dans leur quête de prouver le préjudice qu’ils ont subi et l’obtention des compensations.
En France, d’autres affaires d’infections nosocomiales ont marqué les esprits telles que l’affaire Johnny Hallyday, ayant contracté le germe «staphylocoque doré» suite à une opération d’une hernie discale et celle qui a vu Guillaume Depardieu se faire amputer d’une jambe après une grave infection nosocomiale.
Chaque année en France, environ 800.000 personnes contractent des infections nosocomiales qui sont responsables de près de 4000 décès.
L’avis du juriste: Par Me Karim Jouaihia (Avocat)
Il faut souligner au début qu’il n’existe pas en droit tunisien de cadre légal précis en matière d’infections nosocomiales, ce qui empêche sérieusement la mise en place d’une vraie stratégie de lutte contre ces infections.
Quoiqu’il en soit, la mise en œuvre des règles générales de responsabilité permet a priori aux tribunaux d’octroyer aux victimes de ce genre d’infections ou à leurs héritiers les réparations adéquates.
En effet, conformément aux règles générales de responsabilité et notamment celles relatives à la responsabilité du fait des choses ; l’établissement de santé, qu’il soit privé ou public (clinique, hôpital, etc.) est responsable de plein droit des infections nosocomiales à partir du moment où la victime prouve l’existence d’un lien de causalité entre l’infection et son séjour dans l’établissement de santé. Ce dernier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant d’une part, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et indispensables pour éviter l’infection, ce qui est très difficile à prouver et d’autre part, que l’infection dépend en réalité soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Toutefois la preuve du lien de causalité entre le séjour de la victime dans un établissement de santé et son infection nosocomiale n’est pas toujours facile à établir, ce qui risque de mettre en péril le droit de la victime à être indemnisée.
Il faut saluer dans ce cadre, le rôle fondamental et historique qu’a joué le tribunal administratif en matière d’indemnisation des victimes des fautes médicales en général et d’infections nosocomiales en particulier. En se basant sur l’idée da la faute présumée ; le tribunal administratif a pu reconnaître la responsabilité de l’établissement hospitalier chaque fois qu’il a été prouvé que la victime n’avait aucune infection lors de son entrée à l’hôpital. La charge de la preuve qui incombe normalement sur le demandeur, en l’occurrence la victime, se trouve ainsi renversée, désormais c’est à l’établissement hospitalier de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
Cette jurisprudence avant-gardiste découle du fameux arrêt Hafsi contre le ministre de la Santé publique (arrêt n° 1078 du 31 décembre 1993) dont les faits de l’espèce sont en rapport avec une faute médicale. A l’époque, M. Hafsi avait été admis à l’hôpital Charles Nicolle pour y subir des examens ordinaires ; une fois ces examens terminés, le staff médical a alors décidé de le soumettre à une nouvelle technique d’examen : «la coronarographie» (examen radiologique permettant de visualiser les artères coronaires sur un moniteur, ndlr), cet examen improvisé était à l’origine d’une hémorragie cérébrale avec perte de connaissance, une fois réanimé M. Hafsi souffrait d’amnésie, de troubles de la parole et d’une paralysie de la main droite, son taux d’incapacité permanent a été évalué à 70%.
Grâce à cet arrêt «révolutionnaire», le tribunal administratif a pu par la suite octroyer des réparations aux victimes d’infections nosocomiales même si l’origine de l’infection demeure inconnue.
Ainsi dans le cadre de l’affaire Samâali contre le ministre de la Santé Publique, (arrêt n° 22281 du 18-06-1999), le tribunal administratif a confirmé le jugement de première instance qui a condamné l’établissement hospitalier à verser des réparations à la victime qui s’est trouvée atteinte d’une infection nosocomiale au niveau du système neurologique suite à son séjour à l’hôpital pour une fracture du bassin.
En définitif, la promulgation d’une loi-cadre paraît indispensable, elle permettra en effet, d’une part, de mettre en place une vraie politique de lutte contre ces infections et de se doter des dispositifs juridiques, humai
Cette enquête a été réalisée avec le soutien d’Arab Reporters For Investigative Journalism (www.arij.net) et encadrée par le Dr. Mark Hunter.


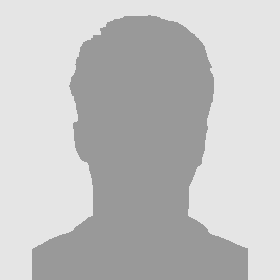

Leave a Reply